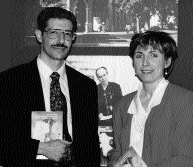
L'auteur et professeur Georges Farid s'entretient avec Julie Régimbal, agente de stages au Département d'informatique, au stand de l'UQO, quelques instants après le lancement de son volume.
JOURNAL DE
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A HULL
(Volume 8,
numéro 9 le 8 juin 1998 )
|
Georges Farid lance un livre sur les homonymes Les impacts des restrictions budgétaires |
La pensée du mois...
«Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que l'on aurait voulu être.» George Eliot.
Les homonymes, ces mots phonétiquement identiques et de sens différents, vous causent des problèmes? Il vous arrive de confondre des termes comme «a», «as», «à»; «ces», «ses», «c'est», «s'est»; «quand», «quant», «qu'en»?
Réjouissez-vous, vous pouvez maintenant disposer d'un outil de consultation aisée pour vous aider à y voir plus clair. Il s'agit d'un nouveau livre que le professeur Georges Farid, directeur du Module des arts et des lettres de l'UQO, a lancé dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais en mars dernier. Son nouvel ouvrage, publié à compte d'auteur, s'intitule Notions grammaticales de base : les homonymes.
L'auteur traite essentiellement des homonymes grammaticaux susceptibles de poser des problèmes orthographiques. «Ils relèvent, pour la plupart, de catégories grammaticales telles que les prépositions, les conjonctions, les adverbes, les pronoms, les adjectifs, les articles, les verbes et les formes conjuguées de verbes.» Georges Farid présente des stratégies élaborées minutieusement et donne des centaines d'exemples présentés avec clarté. Il expose également des mises en application bien structurées.
Le nouveau livre de 228 pages renferme les homonymes les plus usuels; ils sont répartis par ordre alphabétique en 73 sections. Le professeur Farid souligne que la publication «deviendra pour vous le fidèle compagnon du dictionnaire et vous aidera à écrire correctement.»
|
|
L'auteur et professeur Georges Farid s'entretient avec Julie Régimbal, agente de stages au Département d'informatique, au stand de l'UQO, quelques instants après le lancement de son volume. |
L'étudiante Julie Ranger, qui termine cette année son baccalauréat en sciences infirmières, formation initiale, est maintenant convaincue : elle exercera sa profession loin des grands centres. De plus, il y a de fortes chances qu'elle le fasse à l'étranger, dans des régions isolées, qui connaissent des situations d'urgence comme des tremblements de terre. Elle ne se visualise pas dans le confort d'une clinique, d'un CLSC ou d'un centre hospitalier ici même au Québec.
Cette conviction, Julie la possède depuis la Rentrée universitaire de l'automne 1996. À ce moment-là, elle revenait à peine d'un séjour de trois mois à l'étranger, dans le cadre d'un projet d'échanges de Jeunesse Canada Monde et de Québec Sans Frontières.
«En plus de m'indiquer que partir loin de mes proches ne m'effrayait pas, cette expérience m'a aussi renforcée dans l'idée de terminer mon bac en sciences infirmières. Auparavant, j'envisageais d'autres orientations. J'ai compris que je pouvais faire quelque chose de très intéressant dans le domaine et que je ne faisais pas des études pour rien.»
Julie a expliqué qu'elle était au nombre des 38 personnes choisies par Jeunesse Canada Monde et Québec Sans Frontières sur les 500 candidatures reçues au concours de l'an dernier. «Les stages se sont déroulés dans quatre pays différents, dont trois en Amérique latine. Le quatrième, c'était le Bénin, sur le continent africain, où je me suis rendue.»
En compagnie de Claudine Morasse, une collègue étudiante en sciences infirmières de l'Université Laval, Julie a travaillé pendant trois mois, à l'été 1996, dans le sud du pays, plus précisément dans le village de Kindo. Sa population est de près de 300 personnes.
Julie Ranger a précisé qu'au total, «huit étudiantes en sciences infirmières participaient au même projet de santé dans quatre villages différents.»
Julie Ranger a précisé que les objectifs du projet étaient multiples, chaque partie ayant les siens. «Pour Jeunesse Canada Monde, il s'agit de faire découvrir aux gens d'ici la réalité en direct tout en permettant de connaître d'autres cultures et de faire connaître la nôtre. C'est aussi une occasion de créer des liens d'amitié et de s'initier au travail sur le plan international.
«Nous n'allons cependant pas sur place pour changer des choses ou pour intervenir dans des guerres ou des famines. C'est plutôt pour nous initier à la manière dont les collectivités là-bas se débrouillent, pour mieux connaître la nature de leurs initiatives, puisque les gouvernements sont moins présents. Les individus et les groupes dans les villages se prennent en main. Au retour, nous sommes invitées à échanger sur notre vécu dans ces milieux.»
Julie avait également ses propres objectifs. «Je voulais me dépayser. Ce n'était pas la première fois que je me rendais à l'étranger mais je ne m'étais jamais intégrée dans les familles d'un village. Je n'avais jamais vécu leur routine.»
Elle a ajouté qu'elle s'y était rendue aussi parce que le projet touchait au domaine de la santé. «Je veux éventuellement travailler dans cette discipline au niveau international, pour des organismes comme l'Unicef ou Québec Sans Frontières. Je voulais savoir si je pouvais me sentir bien dans un tel milieu. Au fil des jours, je me suis rendu compte que j'étais dans mon élément.»
|
Julie Ranger, en compagnie d'Espédi, 2 ans et demi, un garçon du village de Kindo, au Bénin. |
(photo : Julie Ranger) |
Julie Ranger a indiqué que sa compagne et elle avaient passé les premières semaines là-bas à s'intégrer aux groupements de femmes qui les recevaient. «Au début, elles ne voulaient pas que nous participions aux tâches; elles nous considéraient comme des invitées.
«Peu à peu, nous avons pris notre place et nous avons pu les accompagner aux champs pour faire des travaux agricoles, comme le défrichage, le labourage de même que la cueillette des aliments. Nous avons aussi aidé à la préparation des repas. Nous nous rendions également dans les autres villages parce qu'il était important d'élargir nos connaissances en rencontrant d'autres personnes.»
Julie a expliqué que, par la suite, l'intégration s'est faite au niveau des dispensaires. «De trois à quatre fois par semaine, nous y faisions surtout de l'observation. Nous avons constaté qu'en matière de soins, les gens là-bas sont habitués à se débrouiller avec ce qu'ils ont.
«Nous avons assisté à de nombreux accouchements. Avec le médecin du dispensaire, nous avons fait de nombreuses visites en brousse pour voir l'organisation et le matériel des centres de santé qui s'y trouvent.
«Au niveau de notre village, nous organisions des sessions d'information sur les notions de santé primaire à partir de ce que les gens avaient à leur disposition. Les femmes ne parlant pas beaucoup le français, c'était les enfants qui nous servaient d'interprètes.»
Julie et Claudine ont aussi tenu de petites réunions «santé» avec l'aide d'un jeune qui traduisait leurs propos.«Nous avons également participé à la construction d'une case; il s'agit d'une petite maison pour entreposer les récoltes. Elle peut en outre servir comme salle de réunion. Nous l'avons érigée à même des crédits disponibles dans notre budget et offerte au village qui nous a accueillies, en guise de remerciement.»
Invitée à traiter des temps forts de son séjour de trois mois au Bénin, Julie Ranger a parlé de ses promenades dans la nature. «J'aimais partir à la découverte des environs. Nous étions dans la saison des pluies; les tempêtes m'impressionnaient beaucoup.»
En outre, il y a eu les nombreux accouchements qui se sont déroulés au dispensaire. «C'était très impressionnant. Ce qui était intéressant aussi, c'était de prendre conscience de la différence entre leur système de santé et le nôtre, notamment en ce qui a trait au confort accordé aux mères qui accouchent. De plus, la dynamique entourant les actes des intervenantes est très différente de la nôtre. Diverses interventions médicales se font avec assez de difficulté.»
Selon Julie, son stage, vécu au Bénin plutôt qu'au Québec, a comporté de nombreux aspects fort intéressants. «La possibilité de m'intégrer à la vie en famille dans une nouvelle culture a rendu l'expérience très enrichissante.» Ce qu'elle a cependant trouvé difficile, c'était d'être toujours avec beaucoup de monde et d'être constamment le point de mire.
Pour la future diplômée de l'UQO, le séjour en sol béninois lui a également appris l'importance d'être plus réceptive face aux différents groupes ethniques. «J'ai pu voir comment les soins sont prodigués là-bas, en comparaison avec ce qui se fait chez nous. Je comprends maintenant comment notre système de santé peut paraître différent pour le nouvel arrivant. L'on doit apporter une attention particulière pour l'y intégrer.»
Julie Ranger a adressé un message à ses consoeurs et confrères étudiants. «Si vous désirez tenter votre chance et vivre ces projets, il faut certes y mettre beaucoup d'énergie. Il est parfois difficile de laisser aller ses gros sabots lorsqu'on arrive ailleurs et qu'on tente de s'intégrer. Mais, toutes les personnes qui en reviennent ne changeraient d'aucune façon le cours des événements qu'ils ont vécus à l'étranger.»

Julie Ranger
Originaire de Dorion, en banlieue sud-ouest de Montréal, Julie Ranger s'est amenée dans l'Outaouais en 1994 pour entreprendre son bac à l'Université du Québec à Hull (UQO). Elle avait dans ses bagages à ce moment-là un diplôme d'études collégiales en sciences de la santé du collège Bois-de-Boulogne, établissement de la région métropolitaine, de même qu'une formation en biologie, suivie à l'Université de Sherbrooke.
Entre la fin de ses études collégiales et le début de ses études universitaires, elle a vécu un temps d'arrêt de six mois pour faire du bénévolat. Amante de la nature, Julie a opté pour les sciences infirmières en raison du côté humain de cette discipline.
L'Ordre des comptables en management accrédités (CMA) et la section de l'Outaouais de cette corporation professionnelle organisent un colloque d'une journée sur les impacts socio-économiques des restrictions budgétaires. Cet événement, qui a pour titre «Tracer sa route, le défi des compressions», aura lieu le 30 mai 1997 au pavillon Alexandre-Taché de l'Université du Québec à Hull (UQO).
L'UQO, la Société de diversification économique de l'Outaouais (SDEO), la Banque Nationale du Canada (BNC) et l'Organisation de développement économique régional (ODER) apportent leur collaboration dans la présentation de cette activité.
Qui de nous n'a pas été touché de près ou de loin par les compressions budgétaires, que ce soit dans le secteur public ou privé? Comme individus, nous avons dû composer avec des proches, des parents ou des amis qui ont perdu leur emploi suite au passage de l'inévitable rouleau compresseur.
L'objectif principal du colloque est de réunir à un même événement des gens qui ont eu à subir les coupures, que ce soit les employeurs, les employés, leurs familles, leurs entourages. Ce sera aussi l'occasion de faire le point sur les circonstances et les conséquences des décisions prises autant par les employeurs que par les travailleurs touchés.
La journée permettra d'obtenir des réponses à certaines questions. «Est-ce que c'était vraiment inévitable?» «Y avait-il des signes avant-coureurs?» «Avons-nous bien réagi?» «Acceptons-nous le défi?»
«La problématique de la violence chez nos jeunes, même à l'école primaire, se traduit par des comportements antisociaux manifestes. Nos jeunes sont sujets à des influences diverses, tant dans la famille que dans tous les autres milieux où ils se retrouvent.
«Il est amplement temps de tenter de contrecarrer les influences négatives qu'ils rencontrent et de renforcer des messages de conduites pacifiques et de conciliation avec les autres. Le présent projet souscrit à cet effort.»
Ces propos sont du professeur Jean-Marc Meunier, du Département de travail social de l'Université du Québec à Hull (UQO). Il est en ce moment responsable scientifique d'une recherche-action que pilote présentement le Centre local des services communautaires (CLSC) des Draveurs, de Gatineau. La Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Outaouais (RRSSSO) lui a accordé une subvention à cette fin.
La démarche se fait auprès de trois groupes-classes de 27 élèves de la deuxième année primaire, inscrits en 1996-1997 à l'école gatinoise La Source, de même qu'auprès de leurs parents.
Le projet s'intitule «Les camaraderies». Il a pour objectif l'implantation et l'évaluation, en milieu scolaire, familial et de quartier, de stratégies d'intervention axées sur l'éducation et la socialisation de l'enfant de 7-8 ans à des comportements pacifiques et de négociation.
Jean-Marc Meunier a expliqué que la littérature pertinente reconnaît que c'est «l'âge critique dans l'apprentissage et l'identification à des comportements violents.»
La recherche-action vise d'abord et avant tout à aider le jeune à s'adapter, dès les débuts de son expérience scolaire, à des conduites susceptibles de lui être utiles tout au long de sa vie.
Le professeur Meunier a indiqué que e projet a démarré en octobre 1996 avec la réalisation, à la grandeur de l'école, d'un sondage d'opinion sur la nature des comportements agressifs associés à la violence et des comportements prosociaux associés aux conduites pacifiques ou de négociation. L'expérimentation a commencé le mois suivant, soit en novembre 1996. Le dépôt du rapport final sur l'ensemble des activités est prévu pour le mois de décembre 1998.
Le professeur Meunier a précisé que la démarche comporte quatre volets. Le premier porte sur «l'expérimentation systématique et contrôlée de stratégies novatrices visant à mieux équiper les enfants à l'étude face aux situations de conflit, ou de différend, souvent génératrices d'agressivité et de violence.»
Diverses observations recueillies auprès des enfants et des parents permettront d'établir des mesures de comportements qui seront utilisées pour dégager les modifications qui pourraient être attribuables aux interventions effectuées.
L'universitaire hullois a ajouté qu'à travers l'incitation à avoir des conduites pacifiques et l'apprentissage de diverses formes d'expression des émotions, les interventions effectuées dans le cadre du projet font «la promotion du bien-être personnel et collectif de ces enfants.»
Elles ont aussi pour but de développer l'expérience de l'entraide et de la solidarité et font, au sein de l'école, la promotion d'une vision d'ensemble des modes de solution de conflits.
Finalement, par la recherche-action, l'on espère contribuer à la diminution de la violence entre les jeunes dans l'école.
Le deuxième volet est destiné à soutenir les parents de ces mêmes enfants dans leur rôle d'éducateurs et de modèles de relations humaines. Cette partie du projet vise à les sensibiliser «aux modes de solution des conflits dans la famille et la société et à leur apprendre à renforcer chez leurs enfants les attitudes et les comportements positifs et constructifs porteurs de solutions équitables et respectueuses des personnes.»
Cette étape a aussi pour but «de leur faire découvrir l'expression concrète et stimulante des limites aux conduites agressantes et destructives et de leur permettre de découvrir des sanctions modérées aux comportements non appropriés.» L'on souhaite également que les parents puissent prendre conscience de leurs responsabilités dans ces domaines et transposer les apprentissages de gestion des conflits dans d'autres situations de leur vie.
Le professeur Meunier a précisé que les deux autres volets du projet touchent l'environnement des jeunes : le milieu scolaire et le quartier. L'objectif est de mettre cet environnement à contribution de sorte qu'il apprenne à renforcer les messages émis et à consolider les efforts des enfants.
Le projet propose aux enseignantes et aux enseignants, particulièrement des classes de deuxième année, de mobiliser l'équipe-école à établir un climat de concertation et d'assurer des interventions qui s'appuient les unes sur les autres autour d'un objectif commun, celui de diminuer de façon observable les formes de conduites violentes à l'école.
Le dernier volet touche la collectivité. «L'intervention se propose ici d'élargir la concertation anti-violence au quartier immédiat de l'école. Elle fait ainsi appel à la collaboration des ressources communautaires, particulièrement en développant ou en revitalisant les réseaux naturels d'entraide qui y existent.»

Jean-Marc Meunier
Jean-Marc Meunier a révélé que les quatre volets «sont articulés à l'intérieur de trois opérations distinctes mais interdépendantes : une intervention d'éducation-socialisation auprès des enfants, une intervention visant à engager le soutien de l'environnement (parents, école, quartier), une évaluation des processus et des résultats.»
L'intervention d'éducation-socialisation auprès des enfants est au coeur du projet. Cette opération a été lancée en janvier et se termine en mai. Elle cherche à apprendre aux enfants à identifier les situations à caractère violent, ou susceptibles de le devenir et à développer les habiletés relationnelles (pensées, attitudes, comportements) susceptibles de les résoudre adéquatement et de façon pacifique. L'on souhaite les habituer à négocier des solutions gratifiantes face à des situations de conflit.
La deuxième opération vise, en complément à la première, à engager le soutien de l'environnement. Elle porte sur la dynamique dégagée, soit par les parents, soit par le milieu scolaire immédiat, soit par les éléments du quartier environnant, ou par les interactions multiples.
Les parents font l'objet d'une intervention structurée misant sur le développement d'habiletés spécifiques. Le milieu scolaire est soumis à une animation singulière, orientée vers la concertation des énergies des intervenants qui supportent les jeunes dans leurs efforts. Le soutien à la collectivité du quartier est, sous une forme similaire, sollicitée à travers diverses initiatives de solidarité et d'entraide.
L'évaluation des résultats constitue la troisième opération. Elle se fera à partir de deux questionnaires différents administrés avant et après l'expérimentation du programme d'éducation-socialisation auprès des enfants. Les enseignants et enseignantes, les parents et les enfants répondent chacun de leur côté aux deux questionnaires.
L'exercice a pour but de vérifier l'effet du programme sur les attitudes et les conduites violentes et pacifiques des jeunes de la deuxième année scolaire.
L'on souhaite également examiner les processus d'implantation des interventions. En outre, l'on colligera et interprétera les perceptions et réactions des parents de même que celles des enseignants et enseignantes.
De plus, les événements vécus en classe et dans l'école et les perceptions qu'en a l'équipe-école seront soumis à une réflexion systématique. Enfin, les démarches d'identification des réseaux de soutien au sein du quartier et les efforts d'entraide et de concertation seront mis en lumière.
Le professeur Meunier a indiqué que le projet, à travers ses trois opérations, touche divers volets de la réalité des enfants visés par la recherche. Il a pour but l'accroissement de leur bien-être personnel et collectif, celui de leurs parents de même que celui du milieu scolaire et social, en développant des facteurs comme l'estime de soi et les habiletés relationnelles.
Jean-Marc Meunier a conclu en ajoutant qu'il s'agit d'arriver à des conditions favorisant la maîtrise des situations à caractère de conflit ou de différend interpersonnel.
«L'objectif est de substituer à des réactions d'agressivité et de violence des conduites de tolérance, d'affirmation positive de soi et des comportements de solidarité et de respect de l'autre.»
Il arrive que des écoles secondaires et des entreprises de l'Outaouais québécois établissent des collaborations en matière de formation professionnelle. Quelles sont les caractéristiques des ententes existantes? Quelles sont les dynamiques qui se mettent en place au moment d'établir ce type d'accord?
Comment ces collaborations évoluent-elles? Quels sont les enjeux pour les partenaires? De quelle taille sont les entreprises collaboratrices?
Voilà autant de questions auxquelles répondront deux membres du corps professoral de l'Université du Québec à Hull (UQO), dans le cadre d'une recherche-action d'une durée de cinq ans. Lorraine Savoie-Zajc et André Dolbec, du Département des sciences de l'éducation, étudieront plus particulièrement les dynamiques qui se mettent en place pour faciliter ou bloquer un fonctionnement harmonieux entre les parties. Ils décriront les changements qui se produisent au sein des milieux partenaires à la collaboration.
Cette recherche-action réunira autour d'une même table des représentants de commissions scolaires de l'Outaouais québécois, ainsi que des représentants du milieu de l'entreprise.
À titre de cochercheurs, ils seront invités à concevoir, développer et mettre en place une expérience-pilote de partenariat de formation. Ils devront y intégrer des mécanismes de collaboration école-entreprise dont les caractéristiques auront été jugées importantes lors de l'enquête.
L'initiative débouchera sur la mise en place d'un véritable partenariat de formation école-entreprise. Un processus d'évaluation continue sera prévu afin de suivre l'évolution de la démarche. Ainsi, il sera possible de raffiner le modèle de collaboration et d'éclairer la compréhension de la dynamique d'implantation.
Les savoirs recueillis pourront être transférés à d'autres contextes de formation. Une attention particulière sera consentie aux retombées de la recherche-action sur la situation de la formation professionnelle au secondaire dans le milieu de l'Outaouais.
La cueillette des données se fera auprès d'une grande variété de personnes. Il s'agira d'élèves, d'enseignants, de superviseurs du milieu, d'administrateurs scolaires et d'entreprises, de parents d'élèves.
La recherche-action hulloise s'inscrit dans le cadre des travaux de l'un des cinq grands réseaux pancanadiens de recherche en éducation et en formation créés en décembre dernier par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). La professeure Savoie-Zajc et le professeur Dolbec sont rattachés au «Réseau de recherche en éducation, formation et emplois», qui regroupe cinq projets. Il est sous la direction de Marcelle Hardy, du Département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).
Le réseau québécois a pour mandat d'analyser l'incidence, favorable ou défavorable, des pratiques actuelles en formation professionnelle sur la transition de l'école au travail, sur l'emploi et sur le cheminement professionnel. Il regroupe des équipes de chercheurs de cinq universités québécoises qui, de concert avec plusieurs collègues d'autres provinces, d'Europe et des États-Unis, étudieront la façon dont se constituent les partenariats efficaces en formation professionnelle.
En outre, le réseau comprend des représentants de 35 organismes, qui oeuvrent notamment dans le domaine de la planification et de l'élaboration des politiques, dans les secteurs de l'éducation et du communautaire; il y a aussi des syndicats et des entreprises.
Le CRSH investira un peu plus de 5,6 millions de dollars dans les cinq réseaux pancanadiens. Chacun d'entre eux recevra environ 225 000 $ par an, pendant une période de cinq ans.
|
|
|
Les 11 et 18 avril dernier, le Syndicat du personnel de soutien de l'Université du Québec à Hull (UQO) tenait pour ses membres une journée-colloque ayant pour thème «Mon perfectionnement, je m'en occupe!». L'activité s'est déroulée à la Cabane en bois rond, sur le boulevard Cité des jeunes à Hull.
Outre la présentation de deux conférences, le programme comportait deux discussions en atelier, la première portant sur les attitudes face aux nouvelles réalités du monde du travail; la seconde posait au départ deux questions : «Qu'est-ce que j'ai à apprendre?» et «Comment je veux l'apprendre?».
Dans un dépliant de présentation de l'activité, le Syndicat explique que «dans le contexte actuel de changement continu, le travail est en mutation, tant dans son contenu que dans sa forme. Il est plus abstrait, plus complexe et plus polyvalent.»
Le document souligne que «les formes d'organisation du travail sont de plus en plus diversifiées : télé-travail, travail en équipes multidisciplinaires, équipes de travail semi-autonomes, etc. Ces changements amènent, entre autres, de nouvelles identités professionnelles, un rehaussement des compétences et des emplois plus qualifiés, d'où l'importance accrue de l'apprentissage continu.»
L'on ajoute que, dans cet environnement, il importe pour chaque personne concernée de prendre un temps de réflexion pour se situer face à ce phénomène de même que pour identifier ses réactions et la nature de son engagement. La journée-colloque se voulait précisément une telle occasion.
La journée avait pour but de permettre aux personnes participantes d'explorer les nouvelles tendances du marché du travail et de l'emploi, ainsi que d'amorcer ou de poursuivre sa réflexion sur son développement professionnel.
L'activité avait en outre pour objectif de permettre d'identifier les compétences que chaque personne aimerait développer pour répondre aux nouvelles réalités de l'emploi de même qu'à ses propres aspirations. Le colloque offrait aussi la possibilité de se donner les moyens pour atteindre ses objectifs de perfectionnement ou de formation.
Quatre personnes-ressources ont été mises à contribution. En matinée, Louise Boivin a présenté une conférence intitulée «Les nouvelles réalités du travail». La conférencière possède une longue expérience de conseil dans les milieux socio-communautaire, gouvernemental et syndical.
Jusqu'à ce jour, les recherches et interventions de Louise Beaudoin ont porté sur l'équité salariale, l'organisation du travail et les changements technologiques, en particulier dans le secteur parapublic québécois. En 1996, elle a coordonné, en partenariat, une recherche portant sur les besoins de formation qualifiante.
En après-midi, Gaston Landry a fait une présentation sur les «Compétences 1997». Le conférencier travaille en gestion des ressources humaines depuis 25 ans. Ses mandats dans les secteurs public et privé sont variés : gestion des ressources humaines, formation, planification de carrière, recherche d'emploi, etc. Il est chargé de cours à l'Université du Québec à Hull.
L'animatrice de la journée a été Brigitte Gosselin. Elle oeuvre dans le monde de l'intervention des groupes depuis 1980. Ses années d'expérience au sein de plusieurs services de formation lui ont permis de bien cerner les enjeux de perfectionnement du personnel. Elle est aussi chargée de cours à l'UQO.
Gaétane Lemaire s'est jointe à l'équipe d'animation en atelier. Consultante et chargée de cours à l'Université du Québec à Hull, elle possède neuf ans d'expérience en formation dans les secteurs public, parapublic, privé et communautaire.
Le Comité de perfectionnement a indiqué que le colloque marquait la première étape de son plan d'actions. «Dans les prochains mois, nous procéderons à une analyse des besoins de perfectionnement et de formation avec l'appui d'une firme spécialisée.
«Les résultats devraient permettre de cibler des axes d'intervention et de mobiliser les membres du personnel autour de thèmes particuliers.
«Dans un deuxième temps, nous voudrions mettre en place un mécanisme de promotion des activités de perfectionnement qui serait alimenté à la fois par le Comité et par l'ensemble du personnel de soutien.»
Le Comité a conclu en ajoutant qu'il «faut reconnaître que nous ne sommes pas "qualifiés à vie". Et, le perfectionnement ou la formation continue est devenu essentiel pour un bon nombre d'entre nous qui aspirons à un développement professionnel et personnel satisfaisant.»

La journée-colloque avait comme
décor la magnifique Cabane en
bois rond sur le boulevard Cité des jeunes à
Hull.
Le professeur Jean-Pierre Deslauriers, du Département de travail social de l'Université du Québec à Hull (UQO), vient de publier un rapport intitulé Les cuisines collectives, c'est plus que la cuisine!. Le document a été rédigé à la suite d'une recherche qui a démarré au mois d'août 1995. Dans ses travaux, l'universitaire hullois avait comme assistante Carole Brisebois.
Le professeur Deslauriers a précisé que les cuisines collectives font l'objet d'un projet de recherche comportant deux volets. Le premier est sous la responsabilité de la professeure Lucie Fréchette, également du Département de travail social de l'UQO; il dresse le portrait de ce type d'organisation dans l'Outaouais.
Le second volet, qui relève du professeur Deslauriers, traite de leur impact sur l'intervention communautaire. La recherche s'est faite auprès de quatre cuisines collectives à Hull, plus précisément situées dans les quartiers Jean-Dallaire et Val-Tétreau, dans le secteur Fournier ainsi que dans la paroisse Saint-Joseph. Les chercheurs ont effectué 42 séances d'observation pour une durée totale de 150 heures.
Le professeur et son assistante ont interviewé individuellement 29 femmes. De ce nombre, 14 avaient abandonné les cuisines collectives pour une raison ou pour une autre. Les 15 autres étaient toujours participantes au moment de la recherche.Le rapport renferme six chapitres. Le premier présente l'origine et le déroulement du projet de même qu'une brève description de la méthodologie.
Le deuxième décrit le fonctionnement concret d'une cuisine collective en prenant comme modèle celle qui est implantée au Centre local des services communautaires (CLSC) de Hull. Il est question des locaux et de l'équipement requis, de la planification des menus, des achats et de la cuisine comme telle.
L'on traite également de règlements.Le chapitre trois présente l'évaluation que les femmes dressent de leur participation. Elles exposent leurs attentes, disent ce qui leur a plu et ce qu'elles ont moins aimé.
Quant au chapitre quatre, il porte sur les changements que produisent les cuisines collectives; c'est là le coeur du projet de recherche. Les auteurs écrivent que ce type d'organisation peut aider dans la lutte à la pauvreté.«Toutes les femmes nous ont dit qu'elles économisaient en participant à la cuisine collective, que leurs plats ne leur coûtaient pas cher, etc. Bref, de ce point de vue, si le CLSC veut essayer d'enrayer les effets de la pauvreté, il s'agit d'un moyen dont les femmes sont les premières à reconnaître l'efficacité.»
Le rapport souligne qu'il «est évident que les cuisines collectives ne peuvent à elles seules régler le problème de l'insécurité alimentaire; elles ne peuvent remplacer une politique sociale et elles demeurent tout de même une action résiduelle.
«Cependant, elles sont efficaces du point de vue des femmes interviewées : n'était-ce des cuisines collectives, des familles auraient de la misère à manger, quand elles ne jeûneraient pas purement et simplement les derniers jours du mois.»
L'équipe de recherche souligne aussi que la cuisine collective constitue une façon de briser l'isolement. «Les femmes apprécient autant sinon plus le fait de sortir que l'économie qu'elles réalisent. Elles aiment rencontrer d'autres femmes, jaser, discuter, etc.
«Il y a bien des frictions entre elles par moments, et c'est parfois la raison invoquée pour abandonner les cuisines, mais rien n'empêche que les cuisines collectives ont beaucoup d'importance comme activité sociale, groupe de rencontre, lieu de partage, etc.»Les chercheurs ajoutent que les cuisines collectives peuvent servir de moyen pour amener les gens à modifier leurs habitudes alimentaires. «C'est peut-être ici que les cuisines sont le plus loin d'atteindre leur objectif, non pas à cause des intervenantes ni de la procédure suivie mais bien parce que les habitudes alimentaires sont difficiles à changer, tout simplement.
En effet, les habitudes alimentaires des Québécois n'ont guère évolué entre 1971 et 1991; si nous savons mieux quoi ne pas manger, nous ne mangeons pas plus ce qu'il faudrait!»Le rapport fait tout de même état de changements. «...les femmes font plus attention à ce qu'elles achètent, elles deviennent des consommatrices plus avisées, elles cuisinent des recettes nouvelles.«Cependant, le transfert de connaissances des cuisines collectives vers la cuisine familiale n'est pas aussi grand qu'espéré quand on le compare aux autres objectifs initiaux.»
Les cuisines collectives jouent un rôle important en contribuant également au développement de l'engagement communautaire. En fréquentant la cuisine, les femmes sont mises en contact avec des possibilités d'engagement et de participation.«C'est évident que les femmes en prendraient peut-être connaissance autrement que par les cuisines mais quand on sait que la pauvreté va souvent de pair avec la pauvreté des réseaux sociaux, la fréquentation des cuisines est souvent le moyen d'élargir le cercle de ses connaissances.»
Les cuisines collectives sont également une source de développement personnel. «La fréquentation des cuisines est aussi pour plusieurs des femmes l'occasion de se découvrir, de reprendre confiance en elles.
«L'une retourne aux études, l'autre veut retourner travailler quand elle ne se trouve pas un boulot, une troisième s'inscrit à des cours.»
Le chapitre cinq démontre que les intervenantes apportent une contribution importante au bon fonctionnement des cuisines collectives.
«Au cours de la recherche, nous avons observé qu'elles jouent un rôle crucial dans le recrutement des participantes, la structuration du groupe, la formation des participantes, l'éducation à la consommation et à l'alimentation saine, le développement personnel des femmes, la sollicitation de fonds et l'évolution de la formule des cuisines collectives.»
Le chapitre six propose une réflexion sur l'apport des cuisines collectives à l'évolution de la pratique de l'organisation communautaire. Enfin, les auteurs présentent quelques recommandations.
Le professeur Jean-Pierre Deslauriers a rappelé que le projet de recherche a été réalisé grâce à une subvention conjointe du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Outaouais (RRSSSO), dans le cadre du programme de subventions en santé publique. Le CLSC de Hull a aussi apporté un appui financier.
|
L'UNISCOPE est le journal mensuel de l'Université du Québec à Hull. Les collaborateurs et les collaboratrices doivent acheminer leurs communications orales ou écrites au Service de l'information et des relations publiques, à la pièce E-2100 du pavillon Alexandre-Taché, au 283, boulevard Alexandre-Taché, au poste téléphonique 3960. Rédaction : Roger Labelle Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec,
Bibliothèque nationale du Canada, |