
JOURNAL DE L'UNIVERSITÉ
DU QUÉBEC A HULL
(Volume 10, numéro
4 le 7 décembre 1998 )
La pensée du mois...
«La nature ne peut "tourner rond" alors que l'être humain va de travers.» Louis René des Forêts.
La professeure chargée de cours Martine Mayrand Leclerc, du Département des sciences infirmières de l'Université du Québec à Hull (UQO), a reçu cet automne un prix d'une association nationale américaine dont les membres sont des infirmières et des infirmiers en néonatalogie.
Le 24 septembre dernier, à Cincinnati, la National Association of Neonatal Nurses (NANN) lui a décerné le Specialty Interest Group (SIG) Leadership Award pour l'année 1998.
Mme Mayrand Leclerc, dont l'enseignement chez nous porte sur la pédiatrie, le leadership et la gestion, a été honorée à titre de gestionnaire en néonatalogie.
En ce moment, elle est chef de l'Unité des soins intensifs néonatals
au pavillon Général de l'Hôpital d'Ottawa; ce service
compte 25 lits. Elle supervise le travail d'une équipe de 135 personnes.
Chargée de cours en soins infirmiers à l'UQO depuis 1989, elle a précisé que la néonatalogie est la science des nouveau-nés.
Cette spécialité médicale prodigue des soins aux bébés de moins de 28 jours, aux nouveau-nés, à la fois les prématurés et ceux qui, même s'ils sont arrivés à terme, ont éprouvé des problèmes au moment de leur naissance.
Le prix de la National Association of Neonatal Nurses des États-Unis a notamment pour but de souligner l'excellence dont a fait preuve la titulaire dans sa gestion de la pratique clinique en néonatalogie.
Il a aussi pour objectif de signaler ses initiatives visant à favoriser l'esprit d'équipe au sein de son personnel de même que la croissance et le perfectionnement des individus qui le composent. Il témoigne également de ses habiletés exceptionnelles de communicatrice.
Mme Mayrand Leclerc est à l'origine de nombreux changements au sein de son unité. Ils ont conduit à l'amélioration des soins infirmiers et à l'augmentation du degré de satisfaction des parents.
L'innovation dont elle a fait preuve dans son approche de la gestion s'est notamment concrétisée par l'implantation du partage des tâches, de l'horaire autogéré par les membres de son équipe et du suivi systématique de la clientèle.
Dans ce dernier cas, elle a conçu des cheminements critiques, comprenant la formation donnée aux parents et les soins prodigués aux bébés, qui ont entraîné des retombées positives sur la durée de l'hospitalisation de même que sur la planification des congés.
Grâce à son étroite contribution, Mme Mayrand Leclerc a largement facilité la structuration de l'Unité des soins intensifs néonatals.
Elle a su concrétiser des idées qui en ont fait la meilleure unité qui soit, à la fois pour les bébés, les parents et le personnel.
Favorable à la formation continue, elle encourage le professionnalisme chez le personnel infirmier et incite son équipe multidisciplinaire à faire preuve de leadership.
Son approche de la gestion est celle de la «porte ouverte». Elle invite son personnel et les parents à exprimer leurs préoccupations et à formuler des suggestions qui pourraient conduire à des changements positifs au sein de son unité.
En plus de son travail de gestionnaire et de professeure à l'Université, Martine Mayrand Leclerc a participé, comme cochercheure, à un projet de recherche subventionné sur les soins kangourou.
Entrepris en 1994, les travaux de l'équipe multidisciplinaire, comprenant un psychologue et des infirmières, sont maintenant terminés; les résultats seront livrés dans un rapport en voie de publication. Précisons que la méthode kangourou se caractérise par un contact peau à peau du bébé sur le corps du parent.
Mme Mayrand Leclerc travaille présentement avec une nouvelle équipe multidisciplinaire dans le cadre d'une autre recherche. Elle porte sur le «lit partagé». Elle étudie les retombées reliées aux soins prodigués à des jumeaux et à des triplets alors qu'ils prennent place dans un même lit.
Soulignons que Martine Mayrand Leclerc est titulaire d'une maîtrise en administration des soins de santé. Sa thèse a porté sur la satisfaction du personnel infirmier qui participe à un projet d'enrichissement de la tâche.
Elle est l'auteure de plusieurs articles qui ont paru dans la revue spécialisée Le Lien. Elle est publiée par l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Outaouais dont Mme Mayrand Leclerc est d'ailleurs la présidente.
Membre honoraire de l'École de nursing de l'Université d'Ottawa, elle a aussi été conférencière dans diverses universités de même que dans le cadre d'événements nationaux.
Le 12 novembre dernier, la professeure chargée de cours Martine Mayrand Leclerc a fait l'objet d'un autre hommage, cette fois sur le plan régional.
Lors d'une activité surprise, sous la forme d'un bien-cuit , elle a reçu un prix de l'Ordre régional des infirmières et des infirmiers de l'Outaouais.
La professeure Louise Dumas, du Département des sciences infirmières de l'UQO, a indiqué que l'activité avait été un franc succès, la principale intéressée ne se doutant de rien jusqu'au moment palpitant tant planifié.
Relatant les principaux moments de la rencontre, la professeure Dumas a précisé que Mme Gyslaine Desrosiers, présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), avait remis à la fêtée une broche en or confectionnée spécialement pour l'occasion.
La présence de la présidente de l'OIIQ a été
grandement appréciée puisqu'il s'agissait pour elle d'un aller-retour
à partir de Montréal uniquement pour participer à la
petite fête. «N'est-ce pas un encouragement superbe pour nous
en région», d'ajouter Louise Dumas.
L'hommage local avait pour but de souligner le leadership dont a fait preuve Mme Martine Mayrand Leclerc aux niveaux régional, interprovincial et maintenant nord-américain avec l'obtention du Specialty Interest Group (SIG) Leadership Award pour l'année 1998. Cet honneur lui a été décerné en septembre dernier par la National Association of Neonatal Nurses des États-Unis.
Les membres de sa famille, des infirmières de la région de même que des représentantes de son personnel à l'Unité des soins intensifs néonatals au pavillon Général de l'Hôpital d'Ottawa étaient de la fête du 12 novembre.
Rappelons que Martine Mayrand Leclerc est membre du Conseil d'administration de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Le 29 mai dernier, 27 étudiantes et étudiants de l'Université ont prêté serment. Le groupe constituait la promotion 1995-1998 à la formation initiale du baccalauréat en sciences infirmières.
La cérémonie s'est déroulée en présence
de membres du corps professoral, dont la directrice du Module des sciences
de la santé à ce moment-là, la professeure Francine
Major, et la directrice du Département des sciences infirmières,
la professeure Marcelle Séguin. Denis Dubé,
qui était alors doyen des études et de la recherche, de même
que la présidente de l'Ordre régional des infirmières
et infirmiers de l'Outaouais, Martine Mayrand Leclerc, ont également
participé à l'activité.
La cérémonie d'assermentation est une tradition. Chaque personne reçoit un parchemin, sur lequel repose le texte du serment, de même qu'une chandelle qui est allumée au moment de prononcer le serment professionnel.
Le feu symbolise à la fois la lumière et la chaleur. La lumière fait référence à la connaissance, aux savoirs acquis pendant les études de même qu'à ceux qui viendront dans l'avenir. La chaleur illustre la compassion qui caractérise la qualité de la présence de l'infirmière et de l'infirmier aux personnes, aux familles et aux groupes. «Lumière et chaleur, connaissance et compassion se conjuguent dans l'exercice de notre profession», d'affirmer Francine Major.
Les personnes qui prononcent le serment s'engagent notamment à garder le secret professionnel et à adhérer au code d'éthique de la profession infirmière. Elles promettent d'assurer la coordination et le suivi des soins au meilleur de leur connaissance et de coopérer avec les autres professionnels de l'équipe de soins.
Elles jurent solennellement de poser les actes qui s'imposent afin d'améliorer la qualité de vie de la collectivité tout en respectant les valeurs et convictions personnelles de chaque individu...d'exercer la profession avec intégrité, disponibilité et diligence.
Les nouveaux membres sont : Mariama Bah, Louis Barrière, Sophie Carrière, Martine Cloutier, Annie Delorme, Christiane Diogo, Katia Drouin, Jessie Dubourg, Suzanne Fontaine, Mélanie Gallant, Nancy Jacques, Nathalie-Ruth Josama, Mohamed Kachcach, Khadija Khabzi, Monique Labelle, Jean-François Laplante, Francis Lebel, Sylvain Lefebvre, Lucie Lévesque, Niyonagize Édouard Mbonyumubanyi, Vo Than Mai Nguyen, Dominique Poirier, Véronique Renaud, Isabelle Rivard, Guylaine Tremblay, Jeannot Voisine et Yanick Zamy.

Les étudiants et les étudiantes au baccalauréat en sciences infirmières, en compagnie de membres de la direction, du corps professoral et du personnel de soutien, lors de la cérémonie d'assermentation.
La professeure Claire Maltais, du Département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Hull (UQO), signe un article qui a été publié dans la revue spécialisée Éducation et Francophonie («Les difficultés d'apprentissage», volume XXV, numéro 2, automne-hiver 1997).
Le texte a pour titre «Le concept de soi des élèves éprouvant des difficultés d'apprentissage». Son coauteur est Yves Herry, de la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa.
Dans un résumé, la professeure Maltais souligne que la recherche dont traite l'article «s'intéresse au concept de soi d'apprenants en difficulté...en le comparant à celui d'élèves n'éprouvant pas de difficultés d'apprentissage.»
Les travaux avaient également pour but de vérifier l'effet du type de difficultés rencontrées sur le concept de soi des apprenants en difficulté. Ils avaient de plus pour objectif de démontrer «l'existence d'un processus compensatoire qui amènerait les élèves à surévaluer leur performance dans certains domaines.»
L'échantillonnage comprend 184 élèves fréquentant les classes régulières de septième et de huitième années. Dans ce groupe, 92 élèves éprouvent des difficultés d'apprentissage.
Les résultats obtenus confirment la relation entre les difficultés d'apprentissage et le concept de soi scolaire. Ils n'ont cependant pas pu confirmer la présence d'un processus compensatoire.
L'universitaire hulloise a indiqué que l'article n'est disponible que sur l'Internet à l'adresse suivante : http://acelf.ca/revue
Soulignons que la revue Éducation et Francophonie est un périodique publié par l'Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF).
Le nouveau baccalauréat d'éducation au préscolaire et d'enseignement au primaire a fêté cet automne sa quatrième Rentrée. Le directeur du Département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Hull, (UQO), le professeur Albert Boulet, a profité de cet anniversaire pour rappeler la place qu'occupent les stages dans ce programme de premier cycle.
Comparativement à son prédécesseur, le bac actuel comprend une année supplémentaire de scolarité; il s'étale maintenant sur quatre ans. Cette prolongation a notamment permis d'augmenter la durée des stages.
Selon le professeur Boulet, cette transformation illustre toute l'importance que revêtent les stages en milieu scolaire. Ils «sont le lieu d'une interaction constante entre la théorie et la pratique par le biais de la réflexion et du dialogue.
«D'ailleurs, l'intégration de la théorie et de la pratique, dans une perspective de développement personnel et professionnel des futurs maîtres, est un concept clé de ce programme.»
Albert Boulet a rappelé que les stages ont pour but de «développer les habiletés et les attitudes nécessaires à l'atteinte d'un degré minimal d'autonomie de fonctionnement professionnel.»
L'universitaire hullois a précisé que «la durée des stages augmente progressivement, passant de 10 jours (60 heures) en première année à 60 jours (360 heures) la quatrième année. En tout, l'étudiant aura passé 120 jours (720 heures) en milieu scolaire.
«Un séminaire d'intégration par année permet au futur professionnel de l'enseignement de faire un retour réflexif sur les notions apprises en classe et les expériences vécues en stage.»
Le premier stage se fait au premier ou au deuxième trimestre. Il s'agit essentiellement d'une étape de sensibilisation à la pratique de l'enseignement et au rôle professionnel; les gens se familiarisent avec les différents aspects de la profession.
C'est aussi une occasion de susciter une réflexion critique sur les observations et les expériences réalisées.
Le deuxième stage, qui dure 20 jours (120 heures), a lieu au troisième ou au quatrième trimestre. C'est à ce moment-ci dans leur programme que les étudiants et les étudiantes s'initient à l'enseignement; ils expérimentent dans la pratique des savoirs d'ordre didactique.
C'est d'ailleurs durant cette période qu'ils commencent à maîtriser des éléments fondamentaux de la didactique et à connaître les programmes. De plus, ils approfondissent leurs connaissances du milieu scolaire et du rôle professionnel de la personne enseignante. En outre, ils poursuivent leur démarche réflexive.
Quant au stage trois, qui s'étale sur une période de 30 jours (180 heures), il se déroule au cinquième ou au sixième trimestre. C'est alors que la personne inscrite s'entraîne pleinement à l'exercice de la profession en assumant la prise en charge graduelle d'une classe.
Elle poursuit sa maîtrise d'habiletés didactiques et amorce le développement d'habiletés pédagogiques et de gestion de classe.
Enfin, le quatrième stage est réalisé au septième ou au huitième trimestre. Il a l'allure d'un «internat». Les étudiants et les étudiantes assurent une prise en charge totale, continue et prolongée de la tâche d'enseignant.
Ils doivent alors démontrer qu'ils ont les habiletés et les attitudes nécessaires à l'atteinte d'un degré minimal d'autonomie de fonctionnement.
«Le Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de l'Outaouais, par le biais de son programme de formation, représente une nouvelle forme de valorisation individuelle et d'engagement social, qui émerge dans un nouveau secteur d'activités, celui de la récupération et de l'environnement.»
Ces propos sont de Sylvie Gaudreau, auteure d'un Cahier de la Chaire de recherche en développement communautaire (CRDC) de l'Université du Québec à Hull (UQO).
Le document, qui forme le numéro 6 de la série «Pratiques économiques et sociales», a pour titre Une entreprise de formation par le travail de jeunes en difficulté : le CFER Outaouais.
La publication donne les résultats d'une étude effectuée en 1997 par Mme Gaudreau, une étudiante qui a complété son baccalauréat en travail social.
Elle précise qu'elle a procédé à une recherche documentaire de même qu'à des entrevues avec des informateurs-clés engagés dans cette initiative.
Sylvie Gaudreau a réalisé ses travaux avec la collaboration de Lucie Beaudoin, étudiante à la maîtrise en travail social et assistante à la coordination de la CRDC, et sous la direction du professeur Louis Favreau, du Département de travail social de l'UQO, coordonnateur de la Chaire.
Sylvie Gaudreau écrit que les objectifs majeurs de l'entreprise communautaire outaouaise, qui fait partie d'un réseau de 18 CFER, répartis dans toutes les régions du Québec, «visent l'intégration et la formation des jeunes en difficulté par des activités économiques.
«Le CFER veut donner davantage de chances aux jeunes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail.»
La professeure Lucie Fréchette (Travail social) signe un autre Cahier du GÉRIS (Groupe d'étude et de recherche en intervention sociale).
Le document s'intitule La prévention/promotion : une avenue
incontournable en intervention sociale. Il a paru en octobre dernier
et constitue le numéro 8 de la série «Recherches».
D'entrée de jeu, l'auteure écrit que la prévention est «un champ partagé par diverses disciplines.» Elle traite ensuite de ses concepts-clés. Elle expose les trois grands modèles en prévention de même que les interventions qui en découlent.
Lucie Fréchette aborde aussi la question des stratégies en prévention et promotion de même que celle des facteurs de réussite des interventions préventives.
Dans sa conclusion, elle déclare notamment que la prévention «devrait étendre son champ d'action jusqu'au niveau de l'élaboration de politiques sociales conditionnant la redistribution de la richesse collective, la réduction des inégalités sociales et le soutien aux personnes et groupes vulnérables ou fragilisés.»
Des chercheurs, des coopérants et même certaines instances
internationales le confirment : la participation des populations locales
est une condition indispensable dans le processus conduisant au développement.
L'expérience vécue à Villa el Salvador est particulièrement
riche à cet égard. Elle est unique en Amérique latine
et renferme des leçons de toutes sortes.
La professeure Lucie Fréchette et le professeur Louis Favreau, du Département de travail social de l'Université du Québec à Hull (UQO), abordent le sujet dans le document intitulé Développement communautaire et économie sociale : l'expérience péruvienne de Villa el Salvador.
La publication qui a paru récemment constitue le numéro 5 de la série «Pratiques économiques et sociales» des Cahiers de la Chaire de recherche en développement communautaire.
Villa el Salvador est un bidonville de 300 000 habitants en banlieue de Lima, la capitale du Pérou. Cette municipalité se caractérise par son haut degré d'organisation sociale.
En effet, plus de 3000 associations y sont actives. Leurs activités se déploient dans un cadre d'organisation communautaire très évolué.
La municipalité a développé un aménagement de son territoire qui correspond à une organisation de la communauté par pâtés de maison autour de 120 places communes.
Les coauteurs soulignent que l'expérience péruvienne fait valoir que plusieurs moteurs de développement longtemps délaissés sont liés à la participation des populations locales. Ils identifient du même coup d'autres éléments de réussite du développement.
Les 11 et 12 juin dernier, trois membres de la Chaire de recherche en développement communautaire (CRDC) de l'Université du Québec à Hull (UQO) ont participé au Colloque «Porte ouverte» de la Petite-Nation et de la Vallée-de-la-Lièvre.
La professeure Lucie Fréchette et le professeur Louis Favreau, du Département de travail social de l'UQO, y ont chacun présenté une conférence.
De son côté, Lucie Beaudoin, assistante à la coordination de la CRDC, a animé les diverses activités durant les deux journées.
La professeure Fréchette a abordé la question des conditions de réussite des innovations en matière de prévention sociale.
Le professeur Favreau, qui est coordonnateur de la CRDC, a traité des contributions de l'économie sociale et du développement économique communautaire dans le développement d'une société démocratique.
Le colloque, qui s'est déroulé dans le décor enchanteur de l'Auberge Viceroy, dans la Petite-Nation, a été organisé par la Corporation de développement communautaire (CDC) Rond Point, de Buckingham. Il a rassemblé dans un même lieu près de 80 intervenants et partenaires communautaires, institutionnels et politiques de la région. Ces personnes ont discuté des préoccupations du territoire du comté de Papineau.
Lucie Beaudoin, qui est étudiante à la maîtrise en travail social de l'UQO, a indiqué que «le colloque a été un vif succès selon les témoignages recueillis auprès des participants.»
Deux jeunes chercheurs belges ont séjourné dans l'Outaouais pendant deux semaines en juin dernier. Ils étaient les invités de la Chaire de recherche en développement communautaire (CRDC) de l'Université du Québec à Hull (UQO).
Leur visite chez nous s'inscrivait dans le cadre d'un séjour de deux semaines au Québec.
L'assistante à la coordination de la CRDC, Lucie Beaudoin, a précisé que ces jeunes s'intéressent au développement économique communautaire. «Ils sont venus au Québec pour se familiariser avec les méthodes qui y sont utilisées afin de pouvoir les transposer chez eux en Wallonie belge. Ils ont également échangé sur les méthodes qui sont en usage dans leur pays.»
En Outaouais, les deux chercheurs belges ont visité différents organismes de développement économique communautaire, soit la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Hull, la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de Papineau, la Corporation de développement communautaire (CDC) Rond Point et le Projet de relance économique et sociale de quartier (PRESQ), de Buckingham.
L'assistante à la coordination Lucie Beaudoin a indiqué que les visiteurs avaient été enchantés par l'accueil chaleureux des gens de l'Outaouais. Ils ont exprimé leur intention de rester en contact avec les différents organismes visités de même qu'avec la Chaire de recherche en développement communautaire de l'UQO.
Le 4 novembre 1998, l'Université du Québec à Hull (UQO) a procédé à l'inauguration officielle de ses Laboratoires de génie informatique au pavillon Lucien-Brault, situé au 101nbsp;de la rue Saint-Jean-Bosco.
Trois salles ont été réaménagées et dotées d'outils d'apprentissage modernes et à la fine pointe de la technologie. Elles représentent un investissement de 725 000 $, dont 105 000 $ pour l'aménagement des locaux et 620 000 $ pour l'achat de l'équipement.
Les nouvelles installations sont destinées à la quinzaine d'étudiantes et d'étudiants admis au nouveau baccalauréat en génie informatique; ce programme a été implanté au présent trimestre d'automne.
L'UQO a embauché trois nouveaux professeurs pour le dispenser. Les Laboratoires serviront notamment aux cours portant sur l'électronique, la résistance des matériaux, l'électrotechnique, l'architecture des ordinateurs et les systèmes digitaux.
Le directeur du Module de l'ingénierie de l'Université du Québec à Hull, le professeur Marek Zaremba, a souligné que «des expériences de laboratoire sont une composante essentielle d'un programme d'ingénierie.»
L'universitaire hullois a ajouté que, grâce à l'UQO, il est possible de suivre une formation en génie informatique en français ici même dans la région, qui est reconnue comme étant la «Silicon Valley du Nord».

(photo : Réal Croteau)
De gauche à droite, Sylvie Rossignol, présidente régionale
de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Denis Dubé, vice-recteur
à l'enseignement et à la recherche, Wojtek J. Bock, directeur
du Département d'informatique, et Marek Zaremba, directeur du Module
de l'ingénierie, lors de l'inauguration le 4 novembre 1998.
Le professeur Zaremba a précisé que l'inauguration des nouvelles installations s'est inscrite dans le cadre de la Journée Carrière tenue au pavillon Lucien-Brault de l'UQO le 4 novembre.
«Nous voulions ainsi permettre aux étudiants et aux étudiantes de l'Université du Québec à Hull de même qu'aux représentants et représentantes des compagnies de haute technologie, de passage chez nous, de visiter les laboratoires et de découvrir les équipements modernes qui y prennent place.»
Marek Zaremba a ajouté qu'au cours de la soirée, des cégépiens et des cégépiennes, de même que le grand public, ont pu à leur tour visiter les lieux.
«Pourquoi les membres vont-ils aux assemblées de leur syndicat? Pourquoi ont-ils recours à ses services, à des degrés qui varient énormément?»
Voilà deux questions, parmi tant d'autres, qui sous-tendent la deuxième phase d'une recherche qu'effectue en ce moment le professeur Renaud Paquet, du Département de relations industrielles de l'Université du Québec à Hull (UQO).
L'universitaire hullois a indiqué que, dans ses démarches actuelles, il emprunte essentiellement le modèle qu'il a conçu il y a trois ans pour réaliser le premier volet de sa recherche.
Cette première étape portait sur les dirigeants syndicaux; la seconde sera plus axée sur la participation des membres aux activités syndicales.
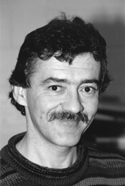 «Aux variables du modèle
initial, j'ajouterai l'effet des stratégies syndicales, parce que
le syndicat a sa part d'influence.
«Aux variables du modèle
initial, j'ajouterai l'effet des stratégies syndicales, parce que
le syndicat a sa part d'influence.
«S'il a un bon réseau d'information pour contacter ses membres individuellement, s'il tient des assemblées qui sont dynamiques et intéressantes, qui parlent des vraies choses qui intéressent les gens, il devrait y avoir plus de monde aux réunions.
«Si sa vision, sa philosophie, son idéologie collent à celles de ses membres, ces derniers vont s'identifier plus facilement à lui, donc ils vont participer davantage.»
Le professeur Paquet a ajouté que sa nouvelle recherche portera sur la dimension qui n'appartient pas à l'individu mais «au syndicat lui-même comme acteur qui influence sa destinée. Il y a en ce moment un vide dans la littérature à ce propos.
«Notre désir ultime est de lier les variables syndicales et organisationnelles avec les variables individuelles.
«Nous allons prendre deux milieux de travail où il y a entre 200 et 300 personnes salariées. Par la suite, nous les appairerons avec deux autres milieux qui sont à peu près identiques.
«Les entrevues que nous réaliserons devraient nous permettre de constater qu'il y a une stratégie propre à chaque milieu.
«Par la suite, nous sonderons les gens individuellement dans le but de déterminer l'influence exercée par ces stratégies sur leur degré de participation.
«Nous pourrons alors livrer à une organisation syndicale les résultats de notre recherche, principalement sur les stratégies gagnantes de même que sur celles qui ont moyennement ou pas d'influence.
«Cette même organisation pourra par la suite transférer les éléments pertinents dans ses plans d'action locaux.»
Le professeur Paquet a indiqué qu'il travaille à l'heure actuelle avec un chercheur des États-Unis et un autre de la Suède.
«Nous voulons tester le même modèle dans trois pays. Si l'on obtient les mêmes résultats partout, cela prouvera que nos modèles sont solides.»
Il a ajouté que ses travaux se font auprès du secteur public, parce qu'il est important dans la région de l'Outaouais.
«La plupart des chercheurs en relations industrielles s'intéressent beaucoup plus au secteur privé. Mais, lorsqu'on constate que le secteur public réunit 50 % de la main-d'oeuvre syndiquée, il importe de s'en occuper.»
Un important colloque se déroulera à Québec, du 1er au 3 février 1999. Et, le directeur du Module des relations industrielles de l'UQO, le professeur Jacques-André Lequin, est étroitement associé à l'organisation de l'événement. Il a suggéré des thèmes de même que des personnes-ressources. De plus, à titre de président d'honneur, il prononcera le mot d'ouverture des 2 et 3 février.
Jacques-André Lequin, qui est également président du Syndicat des professeurs de l'UQO, a précisé que le colloque avait pour titre «Forum patronal-syndical, secteurs public et parapublic». Il a indiqué que l'activité sera très pertinente, compte tenu du contexte actuel. «Les relations de travail et le climat de travail sont en mutation. Il est temps d'agir et de rebâtir.
«Le colloque permettra de réfléchir sur la façon de parvenir à un partenariat durable adapté aux réalités que vivent les diverses parties dans leur propre milieu. La rencontre de février constituera une chance unique pour assimiler tous les éléments essentiels en vue de parvenir à la concertation. Ce sera aussi l'occasion de revoir et d'améliorer les comités d'organisation du travail et d'adapter le travail à la décentralisation.»
Il sera également question de la façon de maintenir un partenariat durable où les négociations se font de manière gagnant/gagnant. L'on verra en outre comment la mobilisation et la responsabilisation du personnel sont possibles dans les secteurs public et parapublic.
Parmi les organisations qui partageront leurs expérience et expertise en matière de parité, il y aura des universités, des ministères canadiens et québécois, des corporations municipales, des centres hospitaliers ainsi que des syndicats des fonctions publiques fédérale, provinciale et municipale.
 Les professeurs Denis Harrisson
et Renaud Paquet, du Département de relations industrielles
de l'UQO, ont publié plus tôt cette année.
Les professeurs Denis Harrisson
et Renaud Paquet, du Département de relations industrielles
de l'UQO, ont publié plus tôt cette année.
M. Harrisson signe, avec Camille Legendre, un article qui a paru en août 1998 dans la revue Études et Recherches, R-196, de l'Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec.
Le texte s'intitule «Étude sur l'impact du mode de gestion
des changements technologiques et organisationnels sur la santé et
la sécurité dans la fabrication des produits en métal
et de produits électriques et électroniques.»
Les deux auteurs ont également livré une communication lors du Congrès mondial de sociologie qui s'est déroulé à Montréal, du 26 juillet au 1er août 1998. Leur présentation s'intitulait «Gestion des changements technologiques et organisationnels et santé et sécurité du travail».
De son côté, M. Paquet et Isabelle Roy sont les auteurs du «Document de recherche 98-2» du Département de relations industrielles. Il a pour titre Les facteurs associés à l'implication comme officier du syndicat local.
Internautes, à votre clavier!!! Un tout nouveau site a récemment fait son apparition sur le réseau Internet. Il a pour titre Adaptation scolaire et sociale de langue française (ASSLF).
Deux professeurs du Département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Hull (UQO), Paul Boudreault et Alain Cadieux, ont été étroitement associés à sa construction.
Ils ont travaillé de concert avec toute une équipe de collègues de l'ensemble des universités francophones québécoises, dont les cinq autres constituantes du réseau de l'Université du Québec, à Montréal, Chicoutimi, Rimouski et Trois-Rivières de même qu'en Abitibi-Témiscamingue.
Cette nouvelle source de renseignements a été créée à l'intention des gens qui s'intéressent aux personnes handicapées et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
Les deux universitaires hullois présenteront prochainement le nouveau site à des représentants et des représentantes de commissions scolaires de la région de même qu'à des étudiants et des étudiantes de l'Université du Québec à Hull.
Les professeurs Paul Boudreault et Alain Cadieux ont indiqué que les membres du corps professoral du Département des sciences de l'éducation participeront également à la présentation qui est prévue pour 16 h le mercredi 9 décembre 1998, à la pièce D-0443 du pavillon Alexandre-Taché.
L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a accordé récemment une bourse d'études de 3000 $ à l'infirmière Mélanie Pichette, de Val-des-Bois.
La boursière a entrepris, au trimestre d'automne 1998, sa deuxième année au baccalauréat en sciences infirmières de l'Université du Québec à Hull (UQO).
Dans un communiqué, Sylvie Vallières, de l'OIIQ, indique que «Mme Pichette s'est tout particulièrement distinguée par son rendement académique et professionnel exceptionnel.»
L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec rappelle que, chaque année, il décerne des bourses d'études afin d'encourager ses membres qui veulent poursuivre des études de premier, deuxième et troisième cycles à temps complet. Pour l'année scolaire 1998-1999, l'Ordre a octroyé 170 000 $ en bourses. Cette somme se répartit comme suit : huit bourses de 10 000 $ à des infirmières inscrites à la maîtrise ou au doctorat en sciences infirmières et 30 bourses de 3000 $ à des infirmières inscrites à un certificat de premier cycle ou au baccalauréat en sciences infirmières.